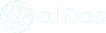La photo-journaliste, Anne Paq, raconte l’histoire derrière l’image d’un jeune Palestinien refusant de lâcher le corps de sa nièce de deux ans.
« Cette photo a marqué la fin de ma vie. Elle est restée dans mes bras jusqu’à ce que nous l’enterrions », a déclaré Mohammed Maadi, 18 ans, un an après le bombardement israélien au cours duquel six membres de sa famille ont été tués.
J’avais pris cette photo de lui près de Rafah deux jours après un bombardement. Il y tient le cadavre de sa nièce de deux ans, Jana.
Israël avait bombardé lourdement et sans discrimination la ville palestinienne en réponse à la capture d’un soldat israélien par des combattants du Hamas. J’étais dans la bande de Gaza pour documenter les victimes du conflit depuis environ trois semaines.
Tôt le matin du 3 août, j’avais sauté dans une voiture avec quelques autres journalistes – une pancarte « TV » montée avec du scotch y avait été hâtivement attachée – et je me suis dirigée vers le sud.
Nous savions que la route serait semée d’embûches et roulions aussi vite que possible. On pouvait entendre des bombes frapper à proximité.
Mes souvenirs de ce jour sont brumeux. Le manque de sommeil nous affectait, en plus du stress et du bilan émotionnel que peut témoigner les atrocités.
J’avais l’impression d’être en pilote automatique : documenter ce que je pouvais, cliquer sur la caméra, prendre des notes, mettre les images en ligne. Nous avions à peine le temps de manger ou de dormir et c’était surtout la nuit, lorsque je révisais et retravaillais les photos, que l’horreur de ce que nous voyions chaque jour me frappait.
Pourtant, cette scène particulière est quelque chose que je n’ai jamais oublié. Nous venions de visiter l’hôpital koweïtien de Rafah, qui avait du mal à faire face au nombre de blessés et de morts, quand on nous a parlé d’un autre endroit – une chambre froide dans un champ agricole où des cadavres avaient été entassés parce que les la morgue et les hôpitaux étaient pleins.
Je me souviens encore de l’odeur insupportable des corps en décomposition dans la chaleur de l’été. Il colle à vous et ne disparaît pas. Des corps au sol, sur des étagères. Des proches tentaient de retrouver leurs proches, de les ramener dans leur famille et de les enterrer, malgré le risque de nouvelles attaques.
Je suis sortie de la glacière et je me souviens être passée devant un camion et avoir vu ce jeune homme assis dans la cabine, accroché à un petit corps enveloppé dans un drap blanc avec un nom écrit en arabe dessus. J’ai pris plusieurs photos et il m’a regardé pendant quelques secondes. Quelques secondes qui ressemblaient à une éternité.
Que devait-il penser de moi, une photographe documentant sa douleur intense?
Il avait l’air tellement brisé. J’ai demandé à quelqu’un d’autre de la famille quel était son nom et j’ai noté « Maadi » dans mon cahier. J’ai découvert plus tard que l’enfant qu’il tenait était la fille de son frère et qu’il refusait de la laisser partir. À ce stade, je ne savais pas ce qui lui était arrivé et il me restait de nombreuses questions sans réponse.
J’ai quitté la bande de Gaza deux jours plus tard, le cœur lourd, inquiet pour les gens que je laissais derrière moi.
Après le cessez-le-feu, je suis revenue et j’ai commencé à travailler sur un projet multimédia collectif, Obliterated Families, sur les familles brisées par l’offensive de 2014. Je savais que je devais rencontrer la famille Maadi pour cela.
Quand je l’ai fait, j’ai découvert comment le bombardement de leur maison avait entraîné la mort de six membres de la famille – le frère de Mohammed, Bassam, 33 ans, la femme de Bassam, Iman, 31 ans, et leurs deux filles, Hala, 3 ans et Jana , 2. Deux autres membres de la famille Maadi ont également été tués dans cette frappe aérienne: Yousef, deux ans, fils d’un autre des frères de Mohammed, et son oncle, Suleiman, 53 ans.
Cela s’était produit le vendredi 1er août, jour qui allait devenir le Vendredi noir, l’un des jours les plus sanglants de l’offensive israélienne. Il y avait eu 31 personnes à l’intérieur de la grande maison familiale de Maadi ce jour-là.
J’ai pu identifier le jeune homme que j’avais photographié – et j’ai appris qu’il s’appelait Mohammed – mais il n’était pas là le jour de ma visite. Au lieu de cela, Ala Qandil, mon co-auteur du projet, a pu le rencontrer plus tard. Il ne s’était jamais remis de la perte de ses proches. Nous avons appris qu’il avait également été blessé lors du bombardement mais avait été sauvé par ses voisins. Il souffre maintenant de problèmes neurologiques et a abandonné son école de mécanique.
En 2017, je suis retournée une fois de plus voir la famille. Cette fois, j’ai vu Mohammed brièvement. Il tenait une autre de ses nièces, une qui avait miraculeusement survécu, et souriait; un sourire que j’essaie aussi de garder dans mes souvenirs.
La photo que j’ai prise de Mohammed et Jana à Rafah me hante toujours. Dans mon esprit, elle sera toujours associée à la douleur et à l’odeur des corps en décomposition, à l’injustice et aux vies brisées – de ceux qui sont morts, mais aussi des survivants. »